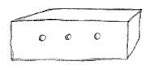3 décembre 2011
22 septembre 2011
30 juillet 2011

la démondialisation et ses ennemis
(...)
une définition finalement très simple
Mais l’on pourrait aussi, à l’exacte opposé, ramener la controverse de la démondialisation à une question d’identification conventionnelle finalement très simple, sous la lumière crue de la conjoncture présente. La concurrence non faussée entre économies à standards salariaux abyssalement différents ; la menace permanente de délocalisation ; la contrainte actionnariale exigeant des rentabilités financières sans limites , telles que leur combinaison opère une compression constante des revenus salariaux ; le développement de l’endettement chronique des ménages qui s’ensuit ; l’absolue licence de la finance de déployer ses opérations spéculatives déstabilisantes, le cas échéant à partir des dettes portées par les ménages ( comme dans le cas des subprimes) ; la prise en otage des pouvoirs publics sommés de venir au secours des institutions financières déconfites par les crises récurrentes ; le portage du coût macroéconomique de ces crises par les chômeurs, de leur coût pour les finances publiques par les contribuables, les usagers, les fonctionnaires et les pensionnés ; la dépossession des citoyens de toute emprise sur la politique économique, désormais réglée d’après les seuls desiderata des créanciers internationaux et quoi qu’il en coûte aux corps sociaux ; la remise de la politique monétaire à une institution indépendante hors de tout contrôle politique : c’est tout cela qu’on pourrait, par une convention de langage peu exigeante, décider de nommer mondialisation.
D’où suit, toujours aussi simplement, que se dire favorable à la démondialisation n’est alors, génériquement, pas autre chose que déclarer ne plus vouloir de ça !
Frédéric Lordon, Le Monde diplomatique août 2011
1 janvier 2011
Une oligarchie au pouvoir

Les liens sont familiaux et s'enracinent dans des cursus scolaires ou des origines géographiques communs. Idéologiquement proches, les membres du réseau sont issus du même milieu social. Les fils tissés entre eux font penser à une toile d'araignée ou , mieux, à ces constructions en trois dimensions dans lesquelles tous les points se trouvent unis à tous les autres.
Les membres de cette oligarchie composent les conseils d'administration de Total ou de BNP Paribas, se rencontrent dans les salons de l'Automobile Club ou à une conférence du Siècle, dans les loges de l'hippodrome de Longchamp ou sur le green du golf de Monfontaine. Ils se croisent chez un antiquaire du quai Voltaire ou dans une galerie de l'avenue Matignon, et participent aux mêmes dîners. Leur appartenance commune aux associations de défense du patrimoine, aux groupes de lobbying, aux amicales d'anciens des grandes écoles finit par gommer les clivages qu'auraient pu induire les spécialisations des fonctions ou des secteurs d'activité. Sans compter les mariages endogamiques qui multiplient les liens familiaux au sein de ce bouillon de culture où se reproduit la classe dirigeante.
( ...)
Charles-Henri Filippi, banquier distingué mais lucide, ayant beaucoup appris pour avoir été président et directeur général du Crédit commercial de France, puis de HSBC France après que le CCF fut passé sous cette marque, a écrit (...) : " La dérive oligarchique risque de ne plus être capable d'offrir de perspective de prospérité qu'à une petite élite pleine d'appétit, plus soucieuse du compromis efficace que de la démocratie et du progrès pour tous". (L'Argent sans maître).
Le président des riches, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot.
18 décembre 2010
LE CONSEIL EUROPEEN ENTEND CONSTITUTIONNALISER LA REGRESSION SOCIALE

Réaction au sommet européen des 16-17 dec.2010
Par Jacques Généreux • Débat européen • Vendredi 17/12/2010
Le dernier sommet européen confirme sans surprise la stratégie insensée poursuivie par les gouvernements de la zone euro, depuis le déclenchement des attaques spéculatives contre la dette grecque. Au lieu de protéger la zone euro et les peuples européens contre les méfaits de la spéculation, ces gouvernements entendent préserver le pouvoir des marchés financiers pour forcer les États récalcitrants à faire converger leurs politiques vers la régression des services publics et des droits sociaux. Au lieu de stopper net la spéculation, en reprenant le contrôle des mouvements de capitaux, l’Union européenne, associée au FMI, instrumentalise la pression des spéculateurs pour forcer les États en difficulté à s’engager dans une cure d’austérité et faire payer au salariés la crise nourrie par la libéralisation financière. Le mécanisme temporaire imaginé pour le sauvetage de la Grèce, visait uniquement à sauver les banques, en faisant payer le prix fort au peuple Grec, en soumettant le gouvernement grec à la tutelle de la Commission et du FMI. Pour mieux rassurer les marchés, l’UE s’est ensuite engagée dans un vaste plan de rigueur coordonné.
Le dernier sommet européen a décidé d’inscrire dans les traités cette manière de gérer les crises financières, en transformant une option temporaire en mécanisme permanent, en renforçant la surveillance préalable des politiques nationales et les sanctions infligées aux États qui s’écarteraient du dogme. Il s’agit d’ôter aux politiques économiques nationales le seul espace de souveraineté jusqu’ici préservé - celui de la politique budgétaire -, en sorte qu’ils ne disposent plus que du dumping social et fiscal pour affronter la libre concurrence et « séduire » les investisseurs. C'est là une façon de constitutionnaliser la régression sociale.
Ainsi, l’Europe est en train de subir le sort que le FMI a réservé aux pays pauvres à la suite de la crise de la dette des années 1980 : les fameux « plans d’ajustements structurels », grâce auxquels les riches du Nord ont imposé leur modèle aux pauvres du Sud. Avec cette différence redoutable que les européens ne sont pas victimes d’une domination étrangère, mais d’un asservissement imposé par leurs propres gouvernements.
Cette politique n’est pas soutenable. En imposant la rigueur généralisée à des pays déjà touchés par le ralentissement de l’activité et la montée du chômage, elle prépare une récession générale et durable en Europe, qui ne fera qu’aggraver le déséquilibre des finances publiques et le risque de défaut sur les dettes souveraines. Elle prépare donc seulement une crise encore plus grave, dont on ne pourra pas davantage sortir par une nouvelle saignée des dépenses sociales, des salaires et des biens publics. La tolérance des peuples à cette rigueur suicidaire a une limite. Les spéculateurs le savent bien d’ailleurs, et c’est pourquoi de nouvelles attaques spéculatives contre la dette publique se répèteront indéfiniment tant que les États ne fermeront pas le terrain de jeu de la spéculation.
Une autre politique est possible et deviendra de toute façon bientôt inévitable. A titre de mesure d’urgence minimale, le conseil européen aurait pu envisager d’interdire l’usage des instruments de spéculation contre les titres de la dette publique (vente à terme et à nu, achat de CDS par des investisseurs ne détenant pas d’obligations). Mais au-delà, la solution durable à la crise de la dette passe par les mesures suivantes :
- restructuration de la dette existante ;
- renationalisation du financement de la dette publique, en réservant les émissions de titres publics aux seuls investisseurs résidents de l’UE ;
- contrôle public des mouvements de capitaux avec les États non-membres de l’UE ;
- pourcentage minimum de détention d’obligations publiques à l’actif des banques et des fonds d’investissements ;
- intervention de banques publiques et de la Banque centrale européenne pour participer directement au financement des besoins publics ;
- suppression de la dépense fiscale qui grève les déficits publics et développement des ressources fiscales prélevées sur les hauts revenus, les revenus du capital et les transactions financières ;
- lutte contre le surendettement privé par la revalorisation des salaires et l’encadrement réglementaire du crédit à la consommation.
En sus des mesures propres à assurer un financement sécurisé, durable et équilibré des biens publics, la zone euro n’est soutenable à terme que si elle engage une stratégie de convergence progressiste des politiques économiques et sociales, à l’opposé de la stratégie actuelle de convergence régressive.
11 décembre 2010
Le retour de l’endettement public

Aujourd’hui, l’Etat reste, à travers les OAT (obligations assimilées du Trésor, bons un peu plus sophistiquées), le débiteur du système bancaire. La dette publique française, qui atteignait 65 % du PIB en 2005, obligeait l’Etat à consacrer plus de 12 % de ses impôts au remboursement. Les Français (tous, et surtout les plus modestes, quand on sait que la fiscalité est essentiellement indirecte à travers la TVA, la Tipp, ou proportionnelle, à travers la CSG) remboursent les prêteurs, en général les gens fortunés.
Etat endetté, Etat soumis.
La grande victoire de la révolution bourgeoise avait été de transformer l’Etat régalien, dispendieux et méprisant de ses créanciers, en débiteur régulier et honnête, en bon débouché de l’épargne bourgeoise. Les deux guerres mondiales avaient redonné à l’Etat son rôle régalien, de meneur de guerre au prix d’un endettement considérable des nations. Le problème des réparations allemandes, la dette de guerre des vaincus de 1914-1918 envers les Alliés, avaient empoisonné les relations politiques de l’entre-deux-guerres, et conduit, selon certains, au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais celle-ci terminée, vainqueurs et vaincus avaient assez vite épuré leur dette grâce à une croissance économique exceptionnelle, accompagnée d’une inflation non négligeable qui eut pour effet de gommer automatiquement la valeur des créances.
Mais voici qu’à partir des années 1970, la dette publique des nations explose à nouveau. Les Etats empruntent de sommes considérables pour payer leurs déficits. Ils émettent des obligations, c’est-à-dire des reconnaissances de dette à moyen et long terme. Ils renouvellent constamment le stock d’obligations. Le marché obligatoire devient extrêmement volumineux à côté du marché des actions. Aujourd’hui, le service de la dette (la paiement des intérêts et le remboursement d’une partie du principal) absorbe près du quart des recettes budgétaires des grands pays (en France, la quasi-totalité de l’impôt sur le revenu). Et favorise l’apparition de cercles vicieux. Dans certains pays, comme en France, les recettes fiscales ne suffisent plus, l’obligation d’emprunter s’impose pour continuer de rembourser sa dette. Cercles vicieux que l’on croyait réservé aux pays non développés.
Qui négocie cette masse énorme de dette publique ? Les grandes banques internationales, les hedge funds (fonds spéculatifs) et les apporteurs d’argent liquide, c’est-à-dire les fonds de pension et les fonds mutuels. En face, se trouvent les demandeurs de capital, les Etats. Ce gros marché détermine le taux d’intérêt. Le taux d’intérêt est donc une variable essentielle qui échappe largement au contrôle des autorités publique. La pression de l’endettement des Etats fait monter les taux d’intérêt. de fait ; les taux d’intérêts réels augmentent considérablement sur la période 1970-2000, pour le plus grand bénéfice des prêteurs qui y trouvent des rémunérations stables de l’ordre de 4 ou 5 %.
En créant des obligations¸les Etats fabriquent de la liquidité : en effet quand les obligations arrivent à échéance, elles sont échangées par leurs détenteurs auprès des banques centrales contre de l’argent frais. Les banques centrales prennent alors leur commission et injectent de la liquidité. De fait, les Etats restent de grands émetteurs de monnaie, mais indirectement. Pour couvrir leur endettement, ils font circuler des obligations qui se transforment en cash. (Le rôle des Etats-Unis est évidemment essentiel. La dette nette est d’environ 2 500 milliards de dollars. L’actif des Américains vis-à-vis de l’étranger est de 10 000 milliards, le passif (les avoirs des étrangers en dollars) de 12 500. Les premiers détenteurs sont les Chinois.) Autrefois, ils actionnaient la planche à billets. A présent, ils laissent faire les banques centrales indépendantes.
D’ailleurs, plus la masse de liquidité et d’obligations en circulation est importante, et moins les banques centrales ont la possibilité de refuser de créer de l’argent. En effet, si les banques privées ne peuvent s’approvisionner en cash auprès de la Banque centrale, eh bien, elles iront directement sur ce gros marché de la liquidité et de l’épargne. Mais surtout, les banques centrales hésitent d’autant moins à approvisionner les banques privées en cash qu’elles n’ont plus peur de l’inflation : le taux de chômage est tellement élevé dans les pays riches que les salaires ne bougent pas. La masse salariale a plutôt tendance à rester stable, voire à se réduire. Le pouvoir d’achat des fonctionnaires diminue. Celui des salariés stagne. Il n’y a plus de risque à injecter de la liquidité dans les économies. L’argent ainsi injecté ne sert à rien : il ne crée ni emploi, ni investissement, ni surcroît de consommation. C’est le phénomène de la trappe à liquidité, merveilleusement analysé par Keynes, selon lequel toute monnaie nouvelle arrivant dans l’économie est thésaurisée dans l’attente de jours meilleurs (et de taux d’intérêt plus élevé). Typiquement, le Japon fut dans une situation de « trappe de liquidité » pendant dix ans : malgré les injections massives de liquidité effectuées par la Banque centrale, rien ne changeait, cet argent servait à alimenter une bulle financière et immobilière : l’inflation du prix des produits, qui avait disparu, était remplacée par une inflation du prix des biens capitaux, actions et immeubles.
Bernard Marris. Antimanuel d'économie. Tome 2.